[Concept du jour] La présupposition
Nous avons défini dans les articles précédents un certain nombre de distinctions portant sur les différents éléments de sens que peut communiquer un énoncé dans une conversation. Il est maintenant temps de prendre le microscope et d’aller voir plus en détail comment le sens global d’un énoncé se décompose. Le concept qui fait l’objet de cet article est la présupposition. Ce terme n’est encore une fois pas inconnu du langage quotidien. Mais comme toujours, lorsqu’on navigue en terrain scientifique, la prudence est de rigueur. Encore qu’ici, l’intuition que l’on peut avoir de ce qu’est une présupposition est assez proche de l’idée que s’en font les linguistes. À ceci près que ces derniers y ont apposé quelques critères qui permettent de donner à cette intuition un contour plus formel. Voyons cela en détail.
Comme on ne change pas une pédagogie qui gagne, nous allons tout de suite illustrer nos propos à l’aide d’un exemple :
- Marie a arrêté de fumer.
Cet exemple contient deux présuppositions. La première, si triviale qu’on n’y pense même pas, est que Marie existe. On appelle cette présupposition la présupposition d’existence. La seconde présupposition, plus intéressante, est que Marie fumait dans le passé. En effet, la sémantique du verbe ‘arrêter’ présuppose que l’on faisait ce qu’on a arrêté de faire. Cette condition – d’avoir fait dans le passé ce qu’on a arrêté de faire – est nécessaire pour que l’énoncé ait un sens. Fort de ce fait, on comprends qu’une présupposition doit nécessairement être vraie pour que l’énoncé soit vrai. Dans le jargon linguistique, on dit d’une présupposition qu’elle est non-annulable. On ne peut pas l’annuler (autrement dit la nier) sans annuler immédiatement la validité de l’énoncé. Je ne peux pas dire « Marie a arrêté de fumer, mais elle n’a jamais fumé ».
Pour les lecteurs assidus, ce constat n’est pas sans rappeler l’idée de condition de vérité. Étant donné qu’une présupposition doit nécessairement être vraie pour que l’énoncé soit vrai, on peut dire que ce que décrit la présupposition est un état du monde qui doit « être le cas » pour permettre à l’énoncé d’être vrai. Or comme les conditions de vérité d’un énoncé sont précisément l’ensemble des conditions qui doivent être satisfaites dans le monde pour qu’un énoncé donné soit vrai, on peut en déduire que la présupposition fait partie de l’ensemble des conditions de vérité. La conséquence de cela est que la présupposition, bien que communiquée indirectement, « sous le chapeau », fait parie du contenu explicite d’un énoncé. Je précise au passage pour ceux qui sont adeptes de Wikipédia que l’article sur la présupposition affirme l’inverse, c’est-à-dire que la présupposition est un contenu implicite. Cela s’explique par le fait qu’on a longtemps considéré l’implicite comme « ce qui est dit indirectement ». Malheureusement, le formalisme plus strict auquel a dû recourir la sémantique pour pallier un certain nombre de problèmes a finalement amené la majorité des linguistes à abandonner cette distinction problématique pour choisir un critère d’opposition moins ambigu – qui a été présenté dans l’article précédent – et ainsi reconnaître à la présupposition son statut de composant de sens linguistiquement encodé, « fourni d’office avec le reste du package sémantique », et donc non sujet à révocation.
Un critère supplémentaire de la présupposition est qu’elle résiste à la négation. Imaginons qu’au lieu de dire « Marie a arrêté du fumer », je dise que « Marie n’a pas arrêté de fumer ». On voit immédiatement que la présupposition reste vraie. Ainsi, que la proposition soit niée ou non, la présupposition est conservée. Certains ont pourtant contredit cette observation en affirmant qu’on peut dire « Marie n’a pas arrêté de fumer, étant donné qu’elle n’a jamais fumé ». Ce fait ne concerne toutefois pas le statut de la présupposition, mais celui de la négation elle-même. Cette ambiguïté, bien connue et traitée avec l’exemple du « Roi de France est chauve », a longtemps été un problème, mais a été résolu par Laurence Horn qui a distingué deux types d’emploi de la négation. Le premier est dit descriptif – c’est l’emploi le plus courant -, et correspond au premier des deux usages présentés. Le second est dit méta-linguistique et fait référence au second exemple présenté. Nous reviendrons sur cette distinction dans un article spécifique lié à la négation.
La dernière caractéristique de la présupposition est qu’elle est redondante. La répétition, dans un discours, de l’information présupposée donne en effet un sentiment de redondance inutile. Il est malvenu de formuler une proposition du type « Marie a arrêté de fumer. Elle fumait. » Nous verrons dans le prochain article que ce critère permet de distinguer la présupposition de l’implication.
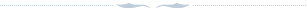
Laissez un commentaire