[Thème] L’ironie
Le thème de l’ironie est extrêmement vaste. Tenter de parvenir à une définition efficace de l’ironie est illusoire, du fait de ses nombreuses formes et de la complexité des phénomènes qui sont en jeu. Les plus grands linguistes (Berrendonner, Sperber et Wilson, Kerbrat-Oreccioni, … ) s’y sont cassé les dents. Le présent article vise uniquement à présenter une description (même pas exhaustive) des différentes formes, ainsi que quelques pistes permettant d’expliquer leur fonctionnement.
Commençons par un rapide survol historique.
La première forme d’ironie recensée est l’ironie socratique, qui était l’art de feindre l’ignorance, afin de renverser finalement la situation et montrer ainsi à l’interlocuteur sa propre ignorance.
Dans la tradition latine, on considère l’ironie sous deux formes. La première est dite antiphrastique. Dans ce sens elle représente une antiphrase, forme de trope (= phrase qu’il ne faut pas prendre au sens littéral, mais figuré, comme une métaphore par exemple). L’antiphrase est une figure par laquelle on emploie un mot ou une phrase, avec l’intention d’en souligner le sens contraire.
Un exemple simple : « Quel temps radieux ! » Alors qu’il pleut.
La seconde forme que prend l’ironie est appelée figure de pensée. Cette forme rend compte de propos ironiques dépassant le cadre de la phrase, et où il est nécessaire d’envisager tout un extrait, voire une oeuvre, où encore un discours, afin d’en saisir la nature ironique.
Revenons un instant sur la notion d’antiphrase, et considérons les deux exemples suivants :
(1) – Je suis enchanté d’apprendre que tu as été licencié de ton collège (dit un père à son fils).
(2) – Je suis enchanté d’apprendre qu’il y a du soleil en Valais (dit un Neuchâtelois).
Ces deux énoncés sont, ou du moins peuvent être compris comme ironiques. Mais l’altération de sens n’est pas la même dans les deux cas. Dans le premier, le père n’est pas enchanté mais consterné, alors que dans le second cas, le Neuchâtelois n’est ni enchanté, ni consterné, mais simplement indifférent. Il est donc important de prendre la notion de sens opposé dans son cadre le plus large.
Si des exemples simples comme ceux mentionnés plus hauts peuvent être expliqués par la forme d’antiphrase, cette vision est trop limitée pour décrire des procédés plus complexes.
Considérons ce dialogue suivant (3) :
Édouard : - Le temps va sa gâter. J’ai un mauvais pressentiment pour notre pique-nique.
A l’heure du pique-nique, le temps est radieux.
Stéphanie : - En effet, quel temps horrible !
Nous sommes toujours en présence d’une antiphrase, mais avec un effet supplémentaire, qui est de tourner en dérision l’inquiétude et le pessimisme d’Édouard. Nous ne pouvons donc plus considérer cette phrase comme un simple trope.
Nous pouvons à ce stade forger une première définition en voyant l’ironie comme une manière de dire l’inverse de ce que l’on semble vouloir dire.
Cette définition, la plus courante, semble satisfaisante, mais peine tout de même à expliquer certains cas. Que dire par exemple des énoncés suivants :
(4) – Je suis le meilleur ! (exagération, indiquant en réalité que je suis simplement content de moi).
(5) - J’aime tellement quand tu me prêtes de l’attention ! (dit une femme à son mari qui regarde la télévision).
Ces exemples ne sont en aucun cas antiphrastiques. Le premier n’est qu’une exagération de la véritable pensée du locuteur, la seconde est absolument vraie même dans son sens littéral. Où est donc l’ironie ?
Entrons donc dans le vif des théories langagières, afin de parvenir à expliquer ces cas plus complexes.
Dan Sperber et Deirdre Wilson, deux éminents linguistes, ont retravaillé la notion d’ironie comme figure de pensée. Pour eux, la clé de compréhension est de considérer l’énoncé, la phrase prononcée, comme une mention et non comme un usage. Ils entendent par là que l’énoncé n’est pas pleinement assumé (usage), mais seulement présenté à l’autre de manière à prononcer un jugement à son encontre.
Dans un exemple simple comme « Quel temps superbe ! » (alors qu’il pleut), celui qui énonce (le locuteur) n’assume pas son propos, il ne « pense pas vraiment ce qu’il dit », mais émet un jugement sur l’énoncé, et par glissement, également sur une personne qui serait susceptible de penser une telle phrase, incongrue dans ce contexte.
Il y a donc dans cet exemple mention d’un énoncé étrange (dans ce contexte), duquel le locuteur se dissocie, afin de se moquer. Autrement dit, dans l’ironie, on ne dit pas vraiment ce qu’on dit explicitement, mais on fait un commentaire ou un sous-entendu, sur ce qu’on énonce. On mentionne donc un fait dans le seul but de le commenter ou de s’en dissocier.
Dans l’exemple (3), Stéphanie mentionne, de façon un peu détournée, le propos énoncé par Jean peu auparavant. Étant donné le temps ensoleillé, on comprend que cette phrase ne peut pas être réellement assumée par Stéphanie, et qu’elle n’en fait mention que pour s’en dissocier, et se moquer d’Édouard.
Cependant, il n’est pas toujours question de ne mentionner qu’un énoncé. On peut également mentionner un acte, voire une attente. C’est le cas dans l’exemple (5). Par sa phrase, l’épouse mentionne une attente, qui à l’évidence est frustrée. Dans ce contexte, cet énoncé marque un décalage entre une réalité désirée et une réalité effective. Ainsi elle indique et déplore que son mari ne fait pas attention à elle.
La prise en compte du contexte est capitale car un énoncé n’est jamais ironique par nature, mais toujours dans un contexte : cadre, locuteur et destinataire(s) précis. Si l’énoncé (2) était prononcé par quelqu’un dont toute la famille habite en Valais, il serait réellement ravi d’apprendre que le temps est radieux là-bas.
On peut développer le sujet très largement et présenter d’autres théories, plus puissantes, mais ça en deviendrait trop laborieux, et je crois que l’essentiel a été dit.
Une dernière chose avant de rendre l’antenne. L’ironie fonctionne à l’aide d’indices laissés à l’interlocuteur pour lui faire comprendre nos intentions. Ces indices sont plus ou moins évidents, ce qui laisse une marge d’erreur, de mauvaise interprétation. Il est fréquent qu’une remarque ironique ne soit pas interprétée comme telle, les indices étant insuffisants. À l’inverse, s’ils sont trop évidents, trop marqués, l’ironie perd sa subtilité, et l’on tombe alors dans le sarcasme.
Ces indices ont également des avantages. Ils permettent dans certains cas de nier la portée ironique, afin de se protéger et d’éviter une réaction désagréable de la part du destinataire.
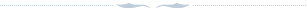
« Quel merveilleux article! »