La grammaire universelle
La Grammaire Universelle (aussi appelée Grammaire Générative) est une théorie élaborée dans les années 50 par le linguiste et philosophe politique Noam Chomsky. Cette théorie est à la fois l’une des plus marquantes et influentes du XXème siècle – bien au-delà du seul champ de la linguistique – mais également souvent mal comprise. Marquante car elle a amorcé la « Révolution cognitive » qui a amené à revoir un grand nombre de connaissances sur le cerveau humain que nous pensions soit acquises, soit inaccessibles, et à développé des pistes de recherche totalement nouvelles dans le domaine des sciences cognitives, des neurosciences, de la psychologie, et même des sciences sociales. Elle est respectivement souvent mal comprise car à première vue totalement contre-intuitive. En effet, la théorie de la Grammaire Universelle postule en substance que tout être humain possède de manière innée une forme de grammaire minimaliste sur laquelle viennent se greffer les stimuli linguistiques disponibles à l’enfant au travers de son environnement, et qui vont générer la langue particulière qui sera sa langue maternelle.
L’aspect contre-intuitif de ce postulat étant, j’imagine, assez évident, nous allons directement examiner les raisons qui ont amené Noam Chomsky et un nombre incalculable de linguistes à suivre cette voie déroutante. Mais avant de poursuivre, il est nécessaire de faire un certain nombre de précisions éclairantes pour bien comprendre les enjeux de la discussion :
- La Grammaire Universelle est une théorie portant sur la syntaxe des langues humaines. Elle a donc pour objectif de décrire les différentes règles régissant la construction des phrases dans les différentes langues humaines, et également d’expliquer pourquoi ces syntaxes sont ainsi et pas autrement.
- Cette théorie ne prétend pas que toutes les langues ont la même syntaxe. Ce serait parfaitement absurde. Elle se contente de postuler qu’au-delà des différences observables entre les différentes langues, il existe un dénominateur commun syntaxique, c’est-à-dire un certain nombre de règles syntaxiques qui sont partagées par toutes ces langues, et que contrairement aux apparences, il existe davantage de similitudes que de différences entre ces multiples syntaxes.
- Ces règles communes sont de très bas niveau structurel. Il n’est donc pas question de dire que l’accord du participe passé, ou encore que la nécessité de dire « Je vais chez le coiffeur » plus que « Je vais au coiffeur » sont des connaissances innées. La Grammaire Universelle opère bien avant d’en arriver à ces considérations. Nous donnerons d’ailleurs plusieurs exemples de ce qu’elle traite.
Pour comprendre ce qui a motivé la naissance de cette théorie, il faut comprendre les alternatives possibles à l’idée d’un bagage cognitif prédisposant l’enfant à maîtriser une langue. Jusque dans les années 50 régnait en linguistique une approche empiriste. Celle-ci considérait que la seule connaissance accessible à l’homme lui vient de sa propre expérience. L’enfant nait donc vide de tout savoir préalable – la « table rase » – et est totalement formaté, construit, par son environnement et son milieu social. Parmi les grands noms porte-étendard de ce courant se trouve Burrhus F. Skinner, l’un des pères fondateurs du béhaviorisme. Cette approche voit l’acquisition du langage comme l’intériorisation de réflexes conditionnés et d’une reproduction par analogie des données auxquelles l’enfant est exposé durant sa période d’apprentissage. Ce dernier entend des phrases, essaie de les répéter, et lorsqu’il bénéficie d’un renforcement positif – une approbation de sa mère, l’obtention de l’objet désiré, etc… - il pérennisera cette construction. Dans le cas contraire, il cessera progressivement de l’utiliser.
Cette vision béhavioriste présente toutefois des difficultés explicatives jugées insurmontables, la rendant improbable d’un point de vue théorique. Nous allons présenter ces défauts, et voir en quoi la Grammaire Universelle est préférable à un modèle postulant une table rase.
Afin de comprendre à quels écueils l’approche béhavioriste – et les approches constructivistes en général – se heurte, il est indispensable de comprendre ce qu’on entend par une syntaxe. Citons ici quelques caractéristiques majeures définissant ce qu’est une syntaxe dans les langues humaines. La première est appelée la récursivité. Bien connue des informaticiens dont les langages qu’ils manipulent partagent les mêmes propriétés syntaxiques, la récursivité permet d’enchâsser à l’intérieur d’une séquence construite sur la base d’une certaine règle, une sous-séquence construite sur la base de la même règle. Les deux énoncés suivants illustrent ce point :
(1) Pierre pense qu’il pleuvra demain.
(2) Marie pense que Pierre pense qu’il pleuvra demain.
L’opération d’enchâssement de la proposition « Il pleuvra demain » à l’intérieur de la structure en « Pierre pense que… » est identique à l’opération réalisée en (2) pour enchâsser (1) dans la construction « Marie pense que… ». Or il est possible de répéter cette opération à l’infini. Toute construction syntaxique X peut être enchâssée dans une construction du type « Pierre pense que X ». La syntaxe permet donc de construire des phrases virtuellement infinies. On nomme cette propriété l’infinité discrète. Une seconde caractéristique de la syntaxe est qu’elle permet de générer, sur la base d’un nombre fini de règles, un nombre infini d’énoncés différents. Ceci est un simple corollaire de ce que nous venons de voir. Imaginons que notre syntaxe ne possède que la règle d’enchâssement en « Pierre pense que X ». On voit immédiatement qu’avec cette unique règle, nous pouvons construire une infinité de phrases différentes :
- Pierre pense qu’il pleuvra demain.
- Marie pense que Pierre pense qu’il pleuvra demain.
- Paul pense que Marie pense que Pierre pense qu’il pleuvra demain.
- Sophie pense que Paul pense que Marie pense que Pierre pense qu’il pleuvra demain.
- …
Bien évidemment, nous ne construisons jamais dans notre conversation quotidienne de phrases infinies. Mais ceci est davantage dû à notre limite mémorielle qu’aux limites de notre syntaxe.
À noter que ces propriétés sont exclusives au langage humain. Aucune forme de langage animal ne partage de syntaxe au sens défini ici.
Que peut-on tirer d’intéressant de ces observations ? Plein de choses pardi ! Premièrement, c’est grâce à cette récursivité syntaxique que l’être humain est capable de générer sans cesse des phrases qu’il n’a jamais entendues auparavant. C’est la dimension créative du langage qui fascinait tant Pascal (le philosophe, pas le joueur de foot). Respectivement, c’est également grâce à cette récursivité que l’on est capable de comprendre des phrases que l’on n’a jamais entendues. Je gage que jamais personne ne vous a dit « J’adore les sandwichs pourpres ! ». Pourtant, vous parvenez sans problème à donner un sens à cette phrase. Ce n’est pas encore assez étonnant ? Alors allons encore plus loin. L’exemple précédent, bien qu’étrange, reste interprétable. Mais la syntaxe se désintéresse totalement du contenu. Vous pouvez avoir des phrases interprétables, bien que grammaticalement incorrectes, comme en (3), et respectivement des phrases parfaitement ininterprétables, bien que syntaxiquement acceptable, comme en (4) :
(3) Le livre que je t’ai parlé est sur la bibliothèque.
(4) Les vertes idées incolores dorment furieusement.
La phrase (3) est récupérable dans l’interprétation, mais on identifie immédiatement l’erreur. De son côté, (4) n’a aucun sens, mais il est manifeste que la syntaxe est respectée.
Se pose alors la question cruciale de ce jugement grammatical que nous sommes tous en mesure d’opérer vis-à-vis de notre propre langue, sans vraiment savoir comment ni pourquoi, et que l’on maîtrise pourtant si tôt dans l’apprentissage. Le fait que nous soyons tous en mesure de juger de (3) comme agrammatical et (4) comme grammatical est en réalité l’élément le plus central dans la théorie de la Grammaire Générative. Toute théorie du langage, et en particulier de son acquisition chez l’enfant, est tenue d’expliquer comment cette capacité de jugement apparaît. Et c’est précisément sur cette pierre d’achoppement que la théorie béhavioriste et autres comparses »table-rasistes » s’encoublent. L’argument-massue énoncé par Chomsky s’appelle l’argument de la pauvreté du stimulus. Allons voir de quoi il retourne.
Pour comprendre cet argument, considérons la règle de construction des phrases interrogatives fermées (dont la réponse est soit oui soit non). Contrairement à l’anglais, le français dispose de différentes options pour construire ces questions ( « Viens-tu au cinéma ? » / « Tu viens au cinéma ? » / « Est-ce que tu viens au cinéma ? » / etc…). Nous nous limiterons dans cet exposé à la première option, qu’on appelle construction par inversion du pronom clitique (terminologie compliquée pour dire qu’on rajoute un « -il / -elle / -tu / … » après le verbe). Prenons l’exemple suivant :
(5) – Pierre prend-il la commande ? {Réponse : – Oui, Pierre prend la commande.}
Sans multiplier les exemples, on se rend vite compte que la construction interrogative se construit sur la base de sa voisine assertive. On sélectionne le verbe conjugué, et on lui colle au derrière le pronom correspondant au sujet, avec un petit tiret entre deux. Jusque-là, tout va bien. Une question se pose toutefois : que se passe-il lorsqu’il y a plusieurs verbes conjugués ?
(6) Pierre prend la commande du client qui est assis au bar.
(6b) Pierre prend-il la commande du client qui est assis au bar ?
Ici, on ne peut plus se contenter de la règle énoncée plus haut. Il faut également spécifier quel verbe doit être sélectionné. Plusieurs possibilités sont imaginables :
- On sélectionne le verbe de la proposition principale.
- On sélectionne le verbe le plus à gauche dans la phrase.
- On sélectionne n’importe lequel.
Si l’on n’observe que (6b), les trois sont possibles. Mais en réalité, une seule de ses règles est valable. Imaginons les exemples suivants :
(6c) * Marie prend la commande du client qui est-il assis au bar ?
(7) L’homme qui est assis au bar est-il servi ?
Remarque : l’étoile * marque l’agrammaticalité.
L’exemple (6c) falsifie la troisième règle en montrant qu’on ne peut pas choisir n’importe quel verbe. L’exemple (7) falsifie la seconde règle en montrant que ce n’est pas toujours le verbe le plus à gauche qui est sélectionné. C’est donc bien la première règle qui est valide. L’énigme qui se pose donc est de savoir comment fait l’enfant pour assimiler cette règle. Doit-il l’apprendre, ou est-elle déjà présente dans son environnement cognitif avant même d’être exposé à des cas naturels ? L’argument de la pauvreté du stimulus démontre que ce ne peut en aucun cas être la première solution ! Mais pourquoi diantre ?! Pour comprendre cet argument, intéressons-nous un instant aux différents stimuli accessibles à l’enfant, sur la base desquels il devrait construire la règle. Si l’enfant n’a aucune connaissance préexistante à son apprentissage, il n’a donc aucune idée a priori de la bonne règle à respecter, les trois règles sont a priori possibles. Pour apprendre laquelle est la bonne, il doit nécessairement exclure les fausses règles. Or pour identifier les règles à ne pas suivre, il n’existe que deux possibilités : identifier un contre-exemple, ou faire l’erreur et être corrigé. L’exemple (7) est bien un contre-exemple à la seconde règle. Soit. On en a éliminé une. Il reste la troisième que l’enfant doit exclure (le choix aléatoire). Mais comment pourrait-il l’éliminer ? Il n’est jamais confronté à des contre-exemples de cette règle potentielle. Il n’entendra jamais un énoncé comme (6c). Et quand bien même il l’entendrait occasionnellement, ça l’induirait en erreur. Il est donc confronté soit à des cas dans lesquels on sélectionne le premier verbe, comme en (6b), soit à d’autres dans lesquels on sélectionne le second, comme en (7). Il est impossible de faire le bon choix sur ces seules données. La prédiction de la thèse béhavioriste étant que l’enfant fonctionne par analogie avec d’autres phrases entendues, il devrait occasionnellement sélectionner le mauvais verbe, et ainsi produire des énoncés tels que (6c), ce qui n’arrive absolument jamais. Un très grand nombre d’études typologiques sur différentes langues ont montré que de telles erreurs n’apparaissent jamais chez les enfants (ni chez les adultes d’ailleurs). Ils font un tas d’erreurs, mais jamais celle-là. Or la seule confrontation aux données provenant de l’environnement ne permet pas d’induire la bonne règle.
Vous n’êtes pas convaincus ? Rajoutons une couche.
Prenons les deux phrases suivantes :
(8) J’ai reçu un livre de Chomsky.
(9) J’ai perdu un livre de Chomsky.
Ces deux phrases sont très similaires. Seul le verbe change. Pourtant, (8) permet la construction de (8b) et (8c), mais (9) ne permet ni de construire (9b) ni (9c) :
(8b) C’est de Chomsky que j’ai reçu un livre.
(8c) De qui as-tu reçu un livre ?
(9b) * C’est de Chomsky que j’ai perdu un livre.
(9c) * De qui as-tu perdu un livre ?
De la même manière, (10) permet de dériver (10b), mais (11) ne permet pas de dériver (11b) :
(10) Le ministre a requis de résister aux pressions financières.
(11) Le ministre a requis la résistance aux pressions financières.
(10b) À quelles pressions le ministre a-t-il requis de résister ?
(11b) * À quelles pressions le ministre a-t-il requis la résistance ?
Expliquer pourquoi ces opérations sont possibles pour (8) et (10) et non pour (9) et (11) rendrait cet exposé inutilement chargé et complexe. Contentons-nous de dire que selon les thèses béhavioristes et constructivistes, l’enfant imite et étend par analogie sur la base de ce qu’il entend. Si tel était le cas, alors il devrait, occasionnellement tout du moins, transformer (9) en (9b) et (9c) par analogie aux transformations possibles de (8) en (8b) et (8c), tout comme il construit occasionnellement « J’ai prendu » sur la base de « j’ai vendu ». Or à nouveau, de telles erreurs ne sont jamais produites par aucun enfant, quelle que soit sa langue. Et ici aussi, les seules données existantes ne permettent nullement à l’enfant d’identifier la bonne règle à respecter. (Ne pas réaliser de déplacement rompant la structure syntagmatique nominale. Voilà, je l’ai dit… Je m’étais pourtant juré…).
Sur la base de ces observations, on comprend pourquoi il est nécessaire de rejeter l’hypothèse d’un apprentissage sur la seule base des énoncés que l’enfant entend. Ceux-ci sont insuffisants pour inférer la bonne règle. À noter au passage que, contrairement à l’idée reçue, l’argument de la pauvreté du stimulus n’est pas tant que l’enfant n’entend pas suffisamment de phrases dans sa phase d’apprentissage pour construire les bonnes règles. Ce n’est nullement une question de quantité, mais bien de qualité. Le fait qu’il n’entende que des phrases bien formées exclut la construction par exclusion des phrases grammaticalement incorrectes. Une fois que l’on a admis que l’expérience seule n’est pas suffisante, il faut trouver une autre explication au fait que tous les enfants de toutes les langues maîtrisent très vite ces règles. Et cette explication… c’est… à votre avis ? Exact ! La Grammaire Universelle !!
On y est. La Grammaire Universelle, c’est ça. C’est l’ensemble des règles inviolables de la langue, que nous n’avons pas à apprendre car nous les connaissons déjà. On ne peut pas questionner le verbe de la construction relative, on ne peut pas briser un syntagme nominal pour en déplacer une partie hors dudit syntagme, et pléthore d’autres règles du genre. Ce sont des règles qui sont imposées par notre système de traitement de l’information, notre outillage conceptuel. L’enfant ne fait jamais ces erreurs car il ne envisage même pas ces constructions potentielles. Elles ne font pas partie des possibilités à disposition dans la structuration des phrases. Vous noterez au passage que de manière identique, on ne fait jamais ce genre d’erreur lorsqu’on apprend une langue étrangère. Admettez qu’on est loin des questions du genre « « Après que », ça prend le subjonctif ou l’indicatif ? ». La Grammaire Universelle constitue la structure grammaticale de base, commune à toutes les langues, sur laquelle se modèle la grammaire d’une langue particulière. Dans le jargon, on appelle les règles universelles des principes, et les règles variables selon les langues des paramètres. Ainsi, la réalisation morpho-syntaxique d’une phrase interrogative est variable d’une langue à l’autre (le français a plusieurs options, l’anglais et l’allemand n’acceptent que l’inversion sujet-verbe, etc…). C’est donc un paramètre que l’enfant doit fixer durant l’apprentissage, par l’expérience. Mais la sélection du verbe sur lequel porte la transformation est imposée par la Grammaire Universelle. C’est un principe, et c’est donc constant quelle que soit la langue. On peut voir notre cerveau comme un gros tableau électrique. Il y a des embranchements qu’on ne peut pas modifier (les principes), et un tas de commutateurs qu’on peut moduler (les paramètres). L’apprentissage consiste, par la confrontation à des données linguistiques extérieures, à fixer la bonne position des commutateurs (la place du verbe à la fin de la phrase en allemand, le complément d’objet en début de phrase en turc, etc…), tout en conservant la structure de base inchangée.
Pour conclure, pour ceux qui sont un peu durs de la feuille, et surtout pour le plaisir, considérons un dernier exemple.
Vous ne le savez peut-être pas, mais vous maîtrisez à merveille ce qu’on appelle grossièrement la co-référence pronominale. Si si. Prenez (12) :
(12) Pierre affirme qu’il est heureux.
Dans cet exemple, le pronom « il » peut reprendre Pierre. Ok ? Ok. Pourtant, en (13), ça ne fonctionne plus :
(13) Il affirme que Pierre est heureux.
En bons linguistes que nous sommes, nous souhaitons savoir pourquoi. Il semble que les pronoms ne puissent pas reprendre n’importe quoi n’importe comment. Quelle règle se cache derrière tout ça ? On pourrait se dire, de prime abord, qu’un pronom ne peut reprendre que ce qui est placé avant lui. En (12), « Pierre » est placé avant le pronom, en (13) non. Ça serait super, si seulement il n’y avait pas l’exemple (14) :
(14) Lorsqu’il joue avec ses enfants, Pierre est heureux.
Le pronom est avant « Pierre », et pourtant il peut sans problème y référer. Il faut donc encore creuser. Et une fois qu’on est allé assez profond, on se rend compte que la règle est un tantinet complexe. Dans la langue obscure des linguistes, on dit qu’on pronom ne peut pas reprendre un élément situé dans le même syntagme c-commandé par ledit pronom. Pour comprendre ce que ce charabia veut dire, il suffit de réécrire les exemples avec des petits crochets. Ces derniers servent à identifier la partie de la phrase qui est sous la portée du pronom :
(12) Pierre affirme qu’ [ il est heureux] .
(13) [ Il affirme que Pierre est heureux ].
(14) Lorsqu’ [ il joue avec ses enfants ], Pierre est heureux.
Lorsqu’on a identifié la délimitation des syntagmes régis par le pronom, on se rend immédiatement compte que lorsque « Pierre » est à l’intérieur, la co-référence est impossible. Lorsqu’il est à l’extérieur, c’est possible. Magique. Et encore une fois, cette règle est beaucoup trop complexe pour que l’enfant puisse la saisir sur la seule base des données à sa disposition. De plus, aucune langue humaine ne déroge à cette règle. Quelques étranges et exotiques que puissent paraître certaines langues, elles se plient absolument toutes à ce principe de co-référence. Hasard ou contrainte mentale ?
Pour vraiment conclure (promis), en plus de s’intéresser aux règles que toutes les langues respectent, il est également intéressant de se demander ce qu’aucune langue ne permet. Une sorte de définition par la négative de ce qu’est la syntaxe. À titre d’exemples, citons des faits comme celui qui consiste à toujours employer les mêmes catégories grammaticales. Toutes les langues ont des verbes, des noms, des adjectifs, des prépositions, des adverbes. Aucun mot d’aucune langue ne sort de ses catégories. Autre fait amusant (d’ailleurs j’en ris encore), un grand nombre de langues, dont le français (en fait l’anglais aussi, mais dans de rares cas), permettent de construire une phrase interrogative par simple modulation de l’intonation, sans aucune modification syntaxique (inversion sujet-verbe par exemple). « Tu viens, oui ou merde ? ». Pourtant, aucune langue au monde ne permet de produire une phrase négative par la seule intonation. Qu’est-ce qui empêche cela ? Pour rester sur les phrases négatives, on pourrait imaginer une syntaxe qui construit les phrases négatives en plaçant le morphème de négation toujours à la même place dans la phrase (par exemple au tout début, ou après le second mot). On aurait donc des phrases du type « Non je viens ce soir », ou « je viens non ce soir » pour « Je ne viens pas ce soir ». En regard de toutes les bizarreries que les langues permettent, cette idée ne paraît pas si invraisemblable. Pourtant, aucune langue n’utilise une telle règle. Il est impossible, quelle que soit la langue observée, de prédire la position du morphème de négation. Etonnant, non ?
Tout ceci constitue l’ensemble de ce que la Grammaire Universelle impose à nos diverses langues. En constante évolution, la Grammaire Universelle est davantage un programme de recherche (appelé programme minimaliste) qu’une théorie établie. S’il existe un consensus massif quant aux thèses fondatrices, il reste encore à définir précisément quelles sont ces règles innées qui contraignent et dirigent notre apprentissage du langage humain, et comment elles entrent en interface avec d’autres modules de la cognition humaine.
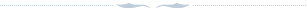
Bien le bonjour !
Vos articles sont formidables et remplissent bien – à mon avis – les objectifs que vous vous êtes fixé, à savoir rendre accessible les vastes notions qui régissent le langage, de manière simple mais justement efficace, pédagogique en somme.
C’est en tant que néophyte total que je m’exprime, mais je suis informaticien programmeur et m’intéresse beaucoup au maillage, sémantique, du langage, et intituivement à cette grammaire universelle fondamentale. Et vous avez réussi à me donner (et certainement à tous les lecteurs du genre) une image beaucoup moins confuse et submergée, synthétique à souhait, de toutes ces notions.
Merci merci merci, continuez s’il vous plaît !