[Concept du jour] Niveaux de sens
Le titre de cet article, bien que pratique, est quelque peu malheureux. Il n’est pas à proprement parler question d’établir une hiérarchie des différentes informations transmises par un énoncé, mais plutôt d’en présenter les différents types, et de les classifier. La seule hiérarchie envisageable est celle qui considère qu’il existe une première partie du sens qui apparait immédiatement, et que nous appellerons le contenu posé, et une seconde partie du sens qui apparait dans un second temps, et que nous appellerons le contenu non-posé. J’entends d’ici les objections que peut amener cette description préalable. Veuillez, je vous prie, rengainer vos armes, et me laisser le bénéfice de la vulgarisation.
Nous devons cette distinction des types de sens aux travaux de Paul Grice, réalisés dans les années 50, et finalisés en 1975 avec son ouvrage Logic and conversation. Par la suite, bien des modifications ont été apportées à sa vision par différents linguistes, et c’est la vision la plus récente qui sera proposée dans cet article et les quatre suivants. Les théories de Grice se basent sur l’observation du fait que certaines phrases communiquent davantage que ce qui semble codé dans leur signification. Autrement dit, la sémantique ne semblait pas en mesure d’expliquer certains effets de sens communiqués par les énoncés. Considérons l’exemple suivant :
(1) J’ai encore perdu mes clés.
Maintenant, voici quelques-unes des informations que l’on peut/doit tirer de cette phrase :
(1a) J’ai perdu mes clés.
(1b) Ce n’est pas la première fois que je perds mes clés.
(1c) J’avais des clés.
(1d) Je n’ai plus de clés.
(1e) Je suis habitué à perdre mes clés.
(1f) Je ne peux plus rentrer chez moi.
(1g) Je suis tête en l’air.
Si les propositions (1a) à (1g) peuvent/doivent effectivement être déduites de la phrase (1), elles ne sont pas toutes obtenues par les même mécanismes déductifs. Les propositions (1a) et (1b) forment ce que j’ai appelé plus haut le sens posé, et sont appelées des explicatures. (1c) est une présupposition. (1d) est une implication. Et finalement, (1e) à (1g) sont des implicatures. Les propositions (1c) à (1g) forment le contenu non-posé. Il faut toutefois préciser qu’un grand débat fait rage pour savoir ce qui appartient au contenu posé et non-posé. Il en sera brièvement question dans les articles suivants.
Les explicatures, les présuppositions et les implications sont considérées comme faisant partie du sens explicite, relevant donc du domaine de la sémantique. En revanche, c’est à la pragmatique de décrire les mécanismes amenant à déduire les implicatures, qui constituent le contenu implicite.
Dans les articles qui vont suivre, nous allons décrire en détail ce que sont ces différents types de sens, leurs caractéristiques, ce qui permet de les différencier, et surtout pourquoi certains relèvent du domaine de la sémantique, autrement dit relèvent du code, et les autres de la pragmatique, autrement dit d’un calcul d’hypothèses a posteriori. Cet article n’avait pour seul but que de montrer qu’il existe un grand nombre d’informations de différents ordres sur la base d’une seule phrase, et qu’il est nécessaire de les décrire pour comprendre précisément comment se construit et s’interprète le sens d’un énoncé lorsqu’il est prononcé.
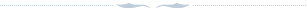
Laissez un commentaire