[Concept du jour] La sémiotique
Au quotidien, nous ne cessons de relever autour de nous des phénomènes, des indices que nous interprétons, auxquels nous donnons du sens. Cela peut aller d’un nuage dans le ciel à une trace de pneu sur la route, en passant par des numéros dans l’annuaire, ou à une conversation dans la rue. Notre environnement grouille de manifestations auxquelles nous donnons une certaine interprétation. Toutes ces manifestations, de nature très diverses, sont appelées des signes. Et c’est le rôle de la sémiotique et de la sémiologie que de les étudier.
La sémiotique, tout comme la sémiologie, s’intéresse à l’objet abstrait qu’est le signe. Mais ces deux sciences ne l’approchent pas de la même manière. La sémiotique s’occupe de définir la nature du signe, ce qui le compose, ce qui le constitue, ce qui le caractérise. La sémiologie, quant à elle, s’occupe d’observer de quelle manière le signe qui a été défini préalablement, fonctionne dans un système de communication. En d’autres termes, la sémiologie a pour but de décrire de quelle manière le signe est intercepté et interprété par les personnes qui l’observent. En définitive, la sémiotique a pour rôle celui de décrire ce qu’est un signe, et la sémiologie celui d’expliquer comment il se manifeste, s’interprète, « fait du sens », dans la vie de tous les jours. L’exigence de concision de ce travail nous oblige à nous concentrer exclusivement sur l’une de ces deux sciences. Il sera donc question ici de décrire la sémiotique, et donc, de décrire ce qu’est un signe.
Prenons un exemple. Marc décide d’aller acheter un t-shirt. Il se trouve devant le vaste choix qui s’offre à lui, et le passe en revue. Il jette finalement son dévolu sur un t-shirt vert pomme. En effet, bien d’autres couleurs étaient disponibles, mais selon lui, le rouge était trop agressif, le jaune trop sportif, l’orange trop vulgaire, le blanc trop neutre, le noir trop triste, le rose trop efféminé, etc. Il a de plus pris le modèle sans motif, car il avait le choix entre un dessin de Mickey trop infantile, la tour Eiffel trop touristique, le visage de Che Guevara trop politique, et le texte « Cambridge University », qui indique soit qu’il y est allé, soit qu’il aurait voulu y aller, ce qui ne lui convient pas dans les deux cas. Il reste donc sur sont t-shirt vert pomme sans motif. L’étiquette indique la lettre « S », qui veut dire Small. Il semble donc qu’il faille connaitre l’anglais pour déterminer la taille de l’objet, mais l’emploi conventionnalisé de cette notation permet à Marc d’interpréter sans problème le sens de la lettre. Il a appris le code. Il voit en dessous plusieurs symboles comme 
Quels sont donc des différents types de signes ? C’est précisément l’une des questions à laquelle la sémiotique tente de répondre. Mais avant de nous pencher sur cette question, il est nécessaire de répondre à la première question concernant le signe : de quoi est-il fait ! Dès l’antiquité, certaines personnes se sont penchées sur la question de savoir quels étaient les constituants du signe. Au final, on en retrouve entre trois et quatre, selon l’école de pensée : le signifiant, le signifié, le référent et le stimulus. Ce dernier est souvent laissé de côté. Nous ferons de même après l’avoir présenté. Le stimulus est la manifestation concrète du signe. C’est l’onde sonore qui atteint notre oreille lors d’une discussion, la lumière qui frappe notre rétine lorsque nous voyons un objet, etc. Mais ce stimulus, pour être interprété, doit correspondre à un certain modèle abstrait, qui fait partie d’un code. Tout son que l’on entend ne peut être interprété. Il faut qu’il fasse partie d’un code que l’on est en mesure de déchiffrer. Ce modèle est le signifiant. Le son d’une sirène, un cercle rouge sur fond blanc, le son « arbre », sont des manifestations sonores ou visuelles s’inscrivant dans un code préalablement appris. Ces signifiants n’ont toutefois d’intérêt que si l’on les associe à un concept, à un objet qui n’est pas lui-même. Ainsi, la sirène renvoie à un signal de mise en garde, le rond rouge sur fond blanc renvoie à une interdiction de circuler, et le son « arbre » renvoie au concept d’arbre. Et finalement, le référent est l’entité particulière qui est désignée dans l’utilisation du groupe signifiant/signifié. Autrement dit, si je dis « l’arbre de mon jardin à cent ans », je désigne une entité précise dans le monde, l’arbre qui est planté dans mon jardin. Le signe est donc composé de ces quatre éléments de façon indissociable. La mise en relation du stimulus au signifiant, du signifiant au signifié, et du signifié au référent s’appelle le processus sémiotique.
Il est important de noter que le signifiant et le stimulus se trouvent sur le plan de l’expression du signe, alors que le signifié et le référent se trouvent sur le plan du contenu conceptuel du signe. Cette séparation permet de distinguer les signes en fonction de leur rapport entre plan de l’expression et du contenu. En effet, selon les contextes, certains signes entretiennent un rapport d’univocité, de bijection. À un signifiant correspond un signifié, et ce de manière unique. Une volute de fumée indiquera la présence d’un feu, les traces de pas indiqueront le passage d’un animal, le noir indiquera le deuil, etc. Ces signes sont indécomposables en unités plus petites, et cela nous permet donc d’établir un rapport unique entre le signifiant et son signifié. On dit qu’ils sont correspondants. En revanche, les mots du langage, pour prendre un exemple parmi d’autres, n’ont pas cette propriété. Les sons qui constituent le mot « arbre » ne contribuent pas indépendamment les uns des autres à la constitution du sens du mot. Ce n’est que mis ensembles, dans un certain ordre, que l’on peut accéder au concept d’arbre. D’ailleurs, les sons constitutifs du langage sont limités, et servent à constituer un nombre illimité d’autres mots. Autrement dit, dans le son « arbre », rien ne renvoie de manière indépendante à la couleur verte, à l’aspect végétal, à la hauteur, etc. C’est l’union d’éléments non signifiants, qui permettent d’en former un plus grand, qui renvoie au concept d’arbre. Ce type de signe est appelé non-correspondant.
On considère également le signe selon que la relation entre signifiant et signifié est arbitraire ou motivée. Dans le cas de la fumée renvoyant au feu, de la mousse sur les arbres indiquant le nord, le lien est dit naturel. En revanche, lorsque le lien entre le signifiant et son signifié correspondant découle d’une construction artificielle, non motivée naturellement, comme c’est le cas de tous les mots du langage humain, on dit que le signe est arbitraire. Pour reprendre l’exemple précédent, rien ne justifie que le concept d’arbre soit dénoté par le son « arbre ». Il pourrait très bien en être autrement, la preuve en est que le même concept a comme signifiant « Baum » en allemand, « tree » en anglais, etc.
Nous avons donc une classification qui permet d’établir quatre catégories de signes, selon leurs caractéristiques : les indices, les icones, les symboles et les signes au sens strict.
L’indice est un signe causalement motivé. C’est la marque de la main sur une joue, témoignant de la gifle, le rond humide laissé par un verre sur une table, la girouette qui montre le sens du vent, etc. Ces signes sont d’une part motivés, et correspondants, car ils sont indécomposables.
L’icone est un signe motivé par ressemblance. Il y a par exemple la carte de géographie, la maquette d’avion, l’image d’un miroir, l’imitation d’un cri d’animal, etc. Ces signes sont motivés, mais ne sont pas forcément correspondants. En effet il est possible d’utiliser les éléments constitutifs de l’icône pour la réutiliser. La couleur employée sur une carte de géographie peut servir à tout autre chose.
Le symbole est un signe associant arbitrairement un signifiant et une abstraction. La croix du Christ, la balance pour la Justice, le vert pour la protection de l’environnement, sont tous des symboles. Un symbole est généralement indécomposable en unités plus petites.
Le signe au sens strict, finalement, est l’élément constitutif des codes les plus sophistiqués. Il est évidemment employé dans le code linguistique, mais également dans les numéros de téléphones, dans les codes barres, etc. Le signe au sens strict est décomposable en unités non signifiantes qui peuvent systématiquement être réutilisées pour la production d’autres signes.
Cette typologie du signe a de nombreuses applications, et touche à un grand nombre de domaines. Elle permet d’aider à l’interprétation et à la compréhension d’éléments constitués de signes qu’il est nécessaire de décoder pour accéder au message. Si il n’est pas nécessaire d’être sémioticien pour saisir le contenu d’un texte ou d’une peinture, l’approche sémiotique permet de révéler et d’expliciter les mécanismes qui sont mis en œuvre pour parvenir à former un message à l’aide d’éléments sans valeur signifiante à priori. Regardons quelques cas :
A l’évidence, il existe une sémiotique du texte et du discours, qui tente de définir en termes d’éléments signifiants les différents genres littéraires que l’on peut rencontrer, comme les romans, les biographies, les textes scientifiques. La poésie fait particulièrement appel à la sémiotique, donnant ainsi naissance à des domaines d’étude comme la rhétorique ou la stylistique.
Mais il existe également une sémiotique des médias, qui prend en considération les affiches publicitaires, politiques, les reportages, etc. Roland Barthes fut l’un des précurseurs en matière d’analyse sémiotique des messages publicitaires. Par extension se développe la sémiotique du spectacle (cinéma, théâtre, etc.), qui considère la parole, la gestuelle, les décors, comme signes.
La sémiotique des codes signalétiques est également importante. Cela touche à la fois les codes routiers, graphiques, et même les blasons et armoiries, qui regorgent d’indices et de symboles, tous porteurs de significations particulières pour qui sait les décoder.
La sémiotique du récit se propose de décrire les éléments systématiques qui fondent la structure d’un récit. Elle met en avant les valeurs prônées, les oppositions, et la façon de les mettre en scène. Elle tente donc de mettre en lumière un schéma universel propre à ce type de textes.
Et finalement, la sémiotique visuelle a une importance capitale. Elle s’intéresse à l’image en général, que ce soit des peintures, des photographies, des dessins, cinéma, etc. En effet, l’image n’est pas interprétable de la même manière qu’un texte, ou qu’un autre outil de communication codé. La question fondamentale que se pose la sémiotique de l’image est de savoir comment on parvient à reconnaitre ce qu’il y a sur une image, de façon presque univoque. Les signes employés dans la représentation picturale ne sont pas du même ordre que ceux décrits précédemment. Ils sont de deux types : les signes plastiques et les signes iconiques.
Les signes plastiques sont ceux qui touchent à la couleur, à la texture, à la forme d’une image. On peut les assimiler aux symboles et aux indices, en ce qu’ils renvoient à un signifié. Les couleurs ont souvent une signification particulière. La nature des traits employés révèlent une certaine émotion. Un flou, par exemple, peut indiquer un sentiment de vitesse, ou de confusion. L’interprétation de ces signes reste toutefois très subjective.
Les signes iconiques, quant à eux, établissent une relation de ressemblance entre le signifiant et le signifié. Ce sont en quelque sorte les éléments qui permettent de dire que le dessin en question représente un chat et non un chien. Il est évident que l’objet réalisé sur la toile n’est pas un animal à proprement parler. Et pourtant, nous parvenons à en identifier la nature sans difficulté. La sémiotique visuelle décrit ce signe iconique comme une relation entre un stimulus, un signifiant, un type et un référent. Ainsi, le stimulus (le dessin) se rapproche du référent (la chose représentée) en ce qu’ils entretiennent des rapports de conformité avec un même type, une sorte de modèle conceptuel, possédant les caractéristiques prototypiques de l’objet représenté. Toute la question est donc de savoir à partir de quel degré d’écart entre le stimulus et le type, le dessin ne représente plus l’objet en question.
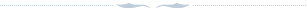
Laissez un commentaire